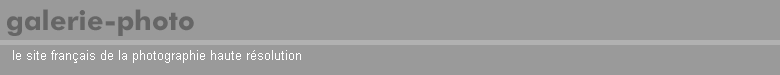|
|
||||||||||||||||||||||||||

L'auteur
Cet article représente
|
Lenteurs helvétiques au temps de la vitesse(Christophe Gallaz, Montreux, le 15 septembre 2007)
La difficulté, lorsqu’on évoque les notions de lenteur et de rapidité, c’est qu’elles sont relatives. Il n’y a pas d’absolu. De l’allure moyenne du Suisse à la progression de la tortue, et de la progression de la tortue aux plissements terrestres induits par le temps géologique, ou de ce temps géologique au rythme du colibri qui bat des ailes 70 fois par seconde aux approches que le caméléon fait de sa proie en conjuguant la lenteur à la rapidité fulgurante, rien ne semble inscriptible dans un périmètre de définition commun. Nous ne savons donc pas vraiment de quoi nous parlons, et le Petit Robert lui-même nous éclaire peu, qui définit mollement la vitesse comme étant “le fait ou le pouvoir de parcourir un grand espace en peu de temps” — or que veut dire grand, et que veut dire peu de temps ? Le Littré, lui, propose un bouquet de définitions plus défavorables: selon lui la lenteur est le «retard à agir» en parlant des personnes, et le «retard à se faire» en parlant des choses. Au figuré, il précise que le mot se dit de l'esprit qui conçoit lentement. Et que la lenteur peut caractériser la marche d'une pièce de théâtre ou d'un roman dans lesquels les événements sont séparés par des conversations ou par des réflexions oiseuses, surabondantes. *** Au sein même de certaines espèces, la notion de lenteur et de rapidité varie d’ailleurs. Prenez l’humaine aujourd’hui. On vient de découvrir que les piétons des villes marchent de plus en plus vite, sans doute sous l'influence de leur vie professionnelle désormais rythmée par les courriels, SMS et téléphones portables. Telle est la conclusion du Britannique Richard Wiseman, professeur de psychologie à l'Université du Hertfordshire. Prenant pour référence des chiffres de 1994, l'équipe universitaire aidée du British Council a mesuré sur une distance de 60 pieds (un peu plus de 18 mètres) la vitesse de piétons dans des artères chargées de villes dans le monde entier. Les allures qui ont le plus augmenté depuis 1994 sont notées en Asie, en particulier à Singapour, qui arrive première sur la liste des villes aux piétons les plus rapides (6,24 km/h). Suivent Copenhague (6,08 km/h) et Madrid, puis Guangzhou en Chine, et Dublin. New York (5,48 km/h) n'est que 8e, Londres 12e, Paris 16e, Tokyo 19e, Le Caire 24e et Bucarest 26e. Les piétons les plus lents d'Europe se trouvent à Berne (3,79 km/h), qui est 30e sur les 32 villes classées par l'Université du Hertfordshire. La capitale fédérale précède de peu Manama au Bahreïn (3,72 km/h) et Blantyre au Malawi (2,08 km/h). Pour resserrerAutrement dit, pour nous approcher du thème abordé ce matin, il nous faut resserrer le concept. Je poserai ceci : aucun rythme n’est excessif dans le sens de la lenteur ou de la vitesse — sauf s’il fait mal advenir les processus du matériau sur lequel il s’exerce (quel que soit celui: vivant, sportif, politique), s’il fait mal être/exister (ou rayonner) et s’il fait mal disparaître, au sens de la disparition faisant renaître. Ainsi se définit le questionnement auquel nous pouvons soumettre le cas suisse. Que le rythme suisse fait-il mal advenir en Suisse (les projets ? les débats liés aux projets ?), qu’y fait-il mal exister (les êtres ? les institutions ?) et qu’y fait-il mal disparaître (les faux souvenirs, les enluminures de l’Histoire ?) ? La parole en généralPour tenter de faire suite à ces interrogations délicates, je retiendrai le paramètre de la parole. Cette dernière est en effet selon moi le moyen cardinal que nous avons de nous instituer dans un rapport juste avec le temps de la vie — de notre vie. Quand je parle et quand je dis justement, je m’articule selon le temps qui m’entoure et qui est le mien. J’en deviens l’incidence organique et sensible. Il y a, entre la parole et le temps qui passe autour de ma personne et qui l’infléchit, une relation essentielle. Mal me dire et mal dire ce que je perçois d’Autrui, c’est me placer hors du champ du temps qui est le mien comme il est celui de l’Autre. C’est me placer dans un temps plus lent, plus endormi, voire prostré, ou plus rapide, qui est le temps de l’illusion personnelle et sociale que je me construis. *** À mes yeux, approcher le thème de la lenteur suisse implique par conséquent d’approcher le thème de la parole en Suisse, de s’interroger sur son tonus ou son anémie, son triomphe ou tout ce qui pourrait l’avoir éteinte ou trafiquée. La parole en SuisseI (l’automutilation)À propos de la parole en Suisse, je commencerais par une hypothèse. A mes yeux les Suisses ont façonné leur sentiment d'identité collective à la faveur d'un processus traumatisant: ils se sont automutilés. Comment, et pourquoi? C’est simple: pour que Confédération se construise, c'est-à-dire pour que les Romands, les Alémaniques et les Tessinois supportent de coexister au sein d'un seul Etat, il a fallu que les uns et les autres procèdent au refoulement de leurs spécificités majeures, réelles ou symbolisées. Un cas l’illustre à mes yeux. On put l’observer au soir du vote du 6 décembre 1992 sur l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen. Vous vous rappelez sans doute que le résultat de ce scrutin fut négatif à 50.3 % contre 49.7 %, et vous vous rappelez surtout ceci: alors que tous les cantons francophones accompagnés des deux Bâle avaient été favorables au projet, tous les cantons alémaniques s’y étaient opposés. Au point que dès le lendemain, de vives interrogations parcoururent la presse romande allant jusqu’à traduire le désir collectif diffus d’une sécession avec les Alémaniques, «avec qui nous n’avons rien à faire». Puis le temps passa, produisant le refoulement momentané (jusqu’à la prochaine occasion) d’une telle idée/pulsion. Telle est, pour moi, l’une des plus spectaculaires illustrations récentes de l’automutilation permanente que j’évoque. II (l’exportation de la violence interne)Deuxième élément. Après le phénomène de l’automutilation, évoquons celui-ci : l’exportation de sa propre violence. Après avoir institué la Confédération, les Suisses ont dû mettre en œuvre en leur propre sein un processus singulier. Pour s’entendre entre eux, ils ont déplacé hors de leurs frontières la masse des hostilités qui régnaient jusqu'alors entre eux. Ils ont décidé, pour ne plus être des adversaires mutuels, que le monde environnant serait leur ennemi systématique à tous. Dès lors il y aurait, par décret de la volonté collective, au moyen d’une représentation collective nouvelle, moins de différences entre un Appenzellois et un Lausannois qu'entre un Genevois et un Savoyard — qui sont pourtant deux voisins géographiques immédiats. Autrement dit :plus on s’allie pour décrier l’extérieur et s’en méfier explicitement et politiquement, plus à l’intérieur on se tait. III (l’auto-admiration)Cette tendance a permis qu’un autre trait collectif se forgeât. Constitués en tant que nation (l’automutilation), et mis dans le déni de leurs complexités internes (l’exportation de leur violence interne), les Suisses ont progressivement pu s’adonner au culte d’eux-mêmes. Ils ont pu s’applaudir comme modèle. Ils ont pu se sentir porteurs d'une intelligence civique et politique d’exception, propre à muer leur État en réalisation remarquable au sein du concert international — même si cette réussite leur a coûté, et leur coûte encore, fort cher. Plus les Suisses se sont présentés en état de perfection aux yeux de l'étranger, en effet, plus ils se sont attristés dans le secret de leur âme et de leur esprit: lorsqu'on se condamne à ne jamais se purger de ses humeurs domestiques les plus naturelles, on se condamne à des douleurs qu'il faut taire et dissimuler. *** On imagine à quel point la parole, celle-là même qui gradue la conscience et son rapport juste avec le temps qui passe, s’en est mal sortie. En Suisse, au fond, les êtres sont liés par un contrat analogue au contrat tacite établi dans le sein des familles. On se maintient en état de rétention verbale, et l’on surveille son voisin de manière à ce qu’il ne commette lui-même aucune infraction à cette norme-là, pour d’autant mieux cultiver la «bonne apparence» de l’édifice sous les regards en provenance de l’extérieur. Il s’ensuit dans des dimensions généralisées, en Suisse, une dépolitisation, une dédialectisation, une dévitalisation de la substance politique, une introversion soucieuse plutôt qu’une formulation cherchante et débattante, et finalement une déverbalisation — qui sont tous, à leur manière, les ferments de la lenteur suisse particulière dont je vais m’efforcer, maintenant, d’évoquer trois périmètres : la neutralité, la culture que j’appelle la culture du péage, et notre pratique institutionnalisée, en politique, du consensus. La neutralitéLa neutralité, d’abord, qu’on peut commencer par percevoir comme un refoulement de la guerre et des pulsions agressives. Dans son Traité de polémologie, Gaston Bouthoul décrit à quel point le besoin d'agresser constitue la vie sous toutes ses formes. Or ce désir, la Suisse se l'interdit depuis 1647, juste avant la fin de la guerre de Trente Ans, quand fut rédigé le «Défensional de Wil» qui définit pour la première fois le dogme helvétique de la neutralité armée — avant que les participants au Congrès de Vienne le garantissent en 1815. Ce principe de neutralité a sans doute ancr�������� dans l’esprit helvétique une obsession essentielle: celle qui vise à conserver un principe d’équidistance entre les protagonistes de la scène internationale. Je veux dire: ni trop près de ceux-ci, ni trop près de ceux-là. Or ce genre de réglage est délicat. Epuisant, aussi. Il réclame un soin de tous les instants. On est à la manœuvre en permanence. Et pendant ce temps on n’a pas le temps, ni l’énergie, de prêter attention à soi pour se construire, ni pour se fortifier, ni pour choisir un cap de manière autonome, ni pour se décrire et se connaître. Ainsi bascule-t-on vers un système comportemental de la prudence, voire de l’attentisme, qui est un creuset de la rétention langagière, et donc un creuset de cette lenteur-refuge évoquée tout à l’heure. En justifiant que nous nous tenions en marge des espaces géographique et idéologique ambiants, le dogme de la neutralité nous confère en effet la double possibilité de nous taire et cependant d'agir en sous-circuit de ce silence. C'est ainsi qu'ont triomphé le mutisme, cultivé autant à l'intérieur du pays que dans les enceintes internationales où s'affronte réglementairement la parole des peuples, et l’activisme commercial que nous avons déployé sur toute la surface du globe. Au rythme marchand qui s’est mis à triompher en surface se sont ajoutés la lenteur de la parole et du caractère en tâche de fond, et les non-dits, produisant cette figure helvétique archétypique de l’autiste d’autant plus performant dans un domaine clairement circonscrit hors de soi qu’il est vertigineusement empêché, effrayé, et lent, à l’intérieur de sa propre personne. La culture du péageÀ cette lenteur-là s’ajoute pour moi celle qui résulte de la culture évoquée voici quelques instants — celle que je nomme du péage. Je pense au récit au Pont du Diable, que je rappelle en quelques mots. Nous sommes il y a sept siècles à Goeschenen, dans le canton d'Uri, au cœur des Alpes suisses. Ce village est situé sur les bords de la Reuss, rivière qu'il faut nécessairement franchir pour gagner le col du Gothard, seul passage permettant alors aux gens et aux marchandises venant de l'Europe du nord de rejoindre l'Europe du sud, et vice-versa. Or la Reuss est une rivière extraordinairement tumultueuse. À chaque fonte des neiges elle emporte le pont qu’il faut constamment reconstruire. Un jour le Diable se présente donc aux villageois en leur proposant d’établir lui-même un ouvrage qui résisterait à toutes les crues de la Reuss. Ainsi pourraient-ils s'enrichir en obtenant, des voyageurs qui l'utiliseraient, une belle somme d'argent. L’important, ce qui m’intéresse aujourd’hui, n’est pas la conclusion du récit mais son sens. Voyons qu’il met en lumière, et qu’il valide, un trait typique des Suisses — spécialisés dans l’art de prélever l'argent des passants et de le faire fructifier dans des coffres conçus tout exprès. C’est en quoi ce conte est symptomatique. Il désigne exactement la vocation du Gérant de péage et du Marchand que les Helvètes ont inscrite en eux depuis leur mise en exploitation du Gothard comme axe de circulation capital entre le nord et le sud de l'Europe. L'esprit suisse, constamment recadré par cette expérience fondatrice au fil des sept siècles suivants (induisant au fil des époques le mouvement des marchandises entre les empereurs germaniques et le monde méditerranéen, puis la vente du bétail en Lombardie par la route du Gothard, l'achat aux Vénitiens du sel nord-africain, l'accueil des filiales de banques florentines à Genève, le mercenariat militaire, l'industrie textile, l'industrie métallurgique puis celles de l'électronique et de la chimie), fait désormais merveille sur la scène économique internationale actuelle, et même sur la scène politique au chapitre des bons offices et des missions charitables. Comme peu de peuples sur la planète, nous sommes parvenus à fusionner notre mal-être intime et notre bien-être matériel, notre angoisse irréductible et notre prospérité conjoncturelle, notre solitude inavouable et nos constructions consensuelles, nos tourments enfouis et notre apparence policée, c'est-à-dire notre suissitude d'automutilés et notre «swissness» exprimée par nos produits et nos prestations. Nous ne sommes pas en possession de nous-mêmes et conquérons simultanément le marché chinois: telle est l'image de nous-mêmes en notre époque. Cette culture du péage est un autre creuset particulier de notre lenteur suisse. Postés sur le Pont du Diable, nous n’avons pas besoin de la moindre rapidité. Nous sommes au contraire dans la catégorie du chasseur à l’affût, qui guette le passage du voyageur en spéculant sur sa richesse. La culture du consensusLe principe du consensus fortifie ce trait. En Suisse il est organisé de la manière la plus fluide et la plus discrète, relevant de ce qu'on nomme en informatique une «tâche de fond» accomplie de manière imperceptible dans les tréfonds de l'ordinateur. Il résulte de négociations généralement lentes et progressives entre les protagonistes qu'il implique, et finit par aboutir sans qu'aucune rupture accidentelle ou tactique ne se soit produite entre eux. Ce style a beaucoup d'incidences sur l’allure générale du dispositif. Il a notamment pour conséquence d'occulter la scène publique et citoyenne: le consensus en lui-même n'est pas un thème excitant pour les médias, et le peuple suisse perd la conscience qu'il pourrait avoir de lui-même. Pourquoi? Parce que la manière feutrée dont se façonnent les ententes, les alliances, les connivences, les compromis et les accommodements qui déterminent sa vie quotidienne finit par l'empêcher d'y voir grand-chose. Ainsi le peuple suisse méconnaît-il aujourd'hui largement sa propre nature complexe, les tensions résiduelles provenant de son Histoire, ses conflits subreptices, ses contradictions ou ses paradoxes, et surtout la divergence abrupte des intérêts spécifiques de ses différentes couches sociales. En somme, et pour retrouver le thème de ce Congrès, il égare les motifs de prendre la parole à son propre sujet. Outre le fait qu’il se nimbe de l’illusion qu’il est en état de cohérence, de cohésion voire d'unicité (alors même qu'il est déchiré dans les faits ou dans la durée), il entre ici dans une lenteur qui est celle non plus de la neutralité et de la culture du péage, mais de l’ignorance de soi par effet d’amortissement et d’assourdissement collectif. Tel est le paysage. *** Une «mauvaise» lenteurÀ partir de ce point soyons subtils. Nous pourrions en effet penser que la lenteur suisse, telle quelle, est un bon moyen de résister à la vitesse aliénante de notre époque. De résister à la vitesse qui nous rend tous nomades du secteur du secteur tertiaire, par exemple — et nous pousse à pianoter sur notre ordinateur portable, à décocher d'incessantes communications téléphoniques sur notre téléphone mobile, à participer à la mécanique exacerbée de la mode et de la contre-mode, à consommer tout ce que nous pouvons à rythme croissant et à ne projeter de vacances qu’aux antipodes. La lenteur suisse, face à cette folie, pourrait sembler sage. Vive le paysan d’Appenzell ! Vive le Suisse formaté par la culture de la neutralité, par celle du péage et par celle du consensus, qui résiste en exhalant trois toupets de fumée par demi-heure à la foulée de notre époque et reste à méditer dans ses refoulements intimes au lieu de marcher, comme le piéton moyen de Singapour aujourd’hui, à 6,24 km/h ! Or non. La lenteur suisse est à la lenteur fertile ce que la mauvaise huile (alimentaire, composée d’acides gras saturés) est à la bonne huile composée d’acides gras insaturés. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le rythme non pas du vivant qui s’épanouit selon la cadence propre de sa croissance et de son déclin, mais d’un système encore marqué par son processus originel de surgissement fondé sur l’automutilation, l’exportation de la violence et l’auto-admiration. Je fais l’hypothèse que l’invention et la réinvention permanente de nous-mêmes, notre aspiration légitime à la beauté du savoir-vivre-ensemble, la décontraction de notre intelligence collective confrontée à l’esprit des pays qui nous entourent et de la Confédération politique elle-même dans le concert des États sur la planète, et le goût de notre mémoire nationale enfin non trafiquée, requièrent une réparation de nos lenteurs suisses pathologiques pour muer ces dernières en lenteurs justes et saines, ou en rapidités justes et saines. L’enjeu ? Il est simple à dire. Il tourne autour du bonheur, de l’art, de l’intelligence/compréhension du temps de la vitesse qui devient le nôtre, et même du ministre populiste Christoph Blocher. Les enjeux de la lenteur juste: le bonheur, l’intelligence de la vitesse, le populisme, l’artD’abord, le bonheur. Se situer dans des lenteurs ou dans des vitesses justes, c’est pouvoir vivre dans une communauté d’humains qui bruisse d’échanges, d’opinions et de confidences, au lieu que ses membres s’entendent muettement sur la base d’un contrat de surveillance mutuelle fondé précisément sur la rareté de la parole «expliquante» et de la lenteur qui lui est consécutive. Ensuite, notre rapport à des gens comme le ministre populiste Christoph Blocher. Laisser des gens comme lui surgir dans le paysage politique suisse, c’est encore une fois une affaire de rétention/d’inculture langagière face à la virtuosité verbale du tribun. La parole lente du peuple l’immobilise en état de stupéfaction face celui qui parle fort. Le mutisme de tous survalorise le verbe de quiconque fait exception sur ce point. Ensuite, le règne ambiant de la vitesse. Être dans un rythme juste est le seul moyen qui nous permettrait d’appréhender de façon critique & intelligente notre époque fascinée par la vitesse. Enfin, notre rapport avec l’art et la création esthétique. La photographie, par exemple. Lorsque vous en êtes un spectateur placé lui-même dans une lenteur juste, elle vous apparaît elle aussi dans sa justesse. Il faut que nous voyons littéralement passer la photographie dans notre regard — au lieu d’en fétichiser le pouvoir de rétention chronologique quand elle est ancienne, ou de laisser glisser dans notre rétine son instantanéité.
Dernière mise à jour : octobre 2007
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||