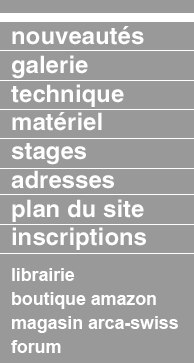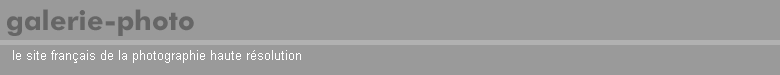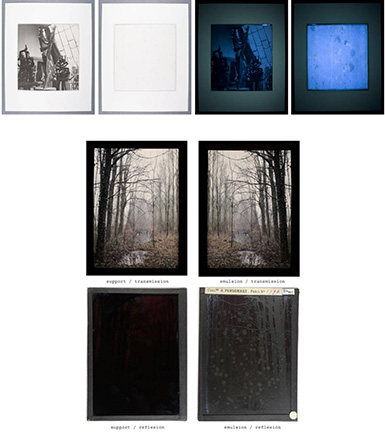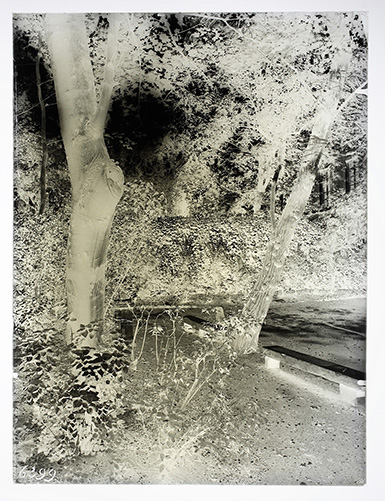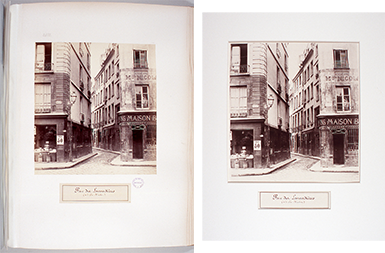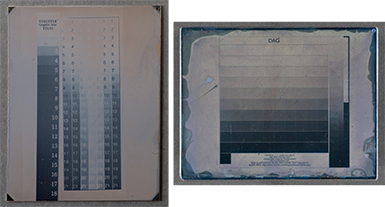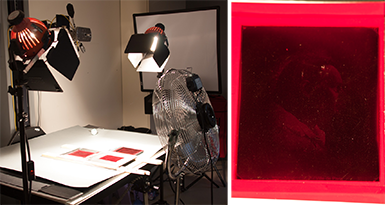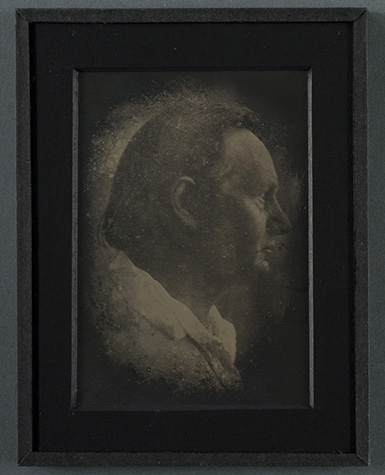Reproduire pour exposer
par Jean-Philippe Boiteux
l'ARCP et ses missions
L’Atelier de Restauration et de
Conservation des Photographies (ARCP) de la Ville de Paris, dirigé par
Anne Cartier-Bresson, compte une quinzaine de personnes qui sont
réparties dans 5 sections : conservation préventive, restauration, régie
des œuvres, documentation et reproduction. Depuis 2006, je suis
responsable de cette dernière section au sein de laquelle je travaille
seul.
La première mission du pôle reproduction
est le suivi des activités de l’ARCP : constat visuel avant et après
restauration, identification des procédés à l’aide de protocoles
spécifiques comme l’utilisation de lumières ultraviolettes ou encore de
loupe trinoculaire, etc.
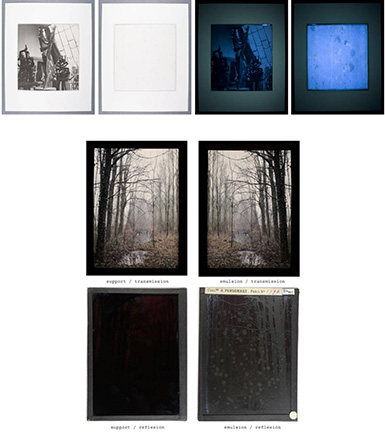
fig.1 Exemples de prises de vue analytiques
Sa seconde mission est la reproduction
patrimoniale : lorsqu’une photographie est trop fragile pour être
présentée correctement au public, ou que les conditions de transport ne
sont pas suffisantes pour la bonne conservation de cette œuvre, nous en
réalisons une copie.
Les techniques de reproduction
Nous distinguons 3 techniques de
reproduction :
- Lorsque le conservateur ne dispose pas
du tirage mais de sa matrice, on procède à un retirage de celle-ci. Il
s’agit alors de restituer l’intégralité des informations qu’elle
contient.
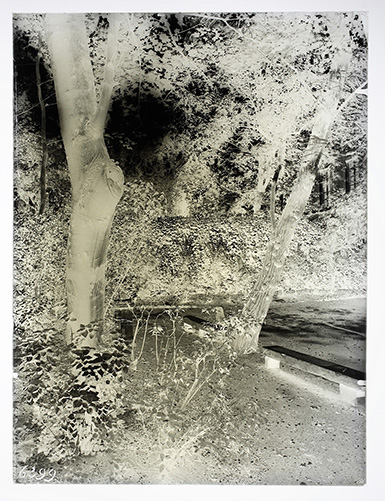
fig.2 Arbres, Eugène Atget,
négatif au gélatino-bromure d’argent

fig.3 retirage sur papier albuminé viré à l’or)
Le contretype et le fac-similé sont tous
deux des reproductions au format de la photographie originale et tentent
de s’approcher le plus possible de ses valeurs au moment de la
reproduction.
- Le contretype est réalisé dans un
procédé contemporain de bonne conservation le plus adapté à une
restitution fidèle.
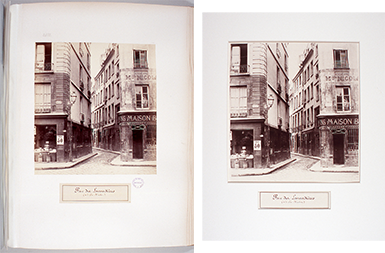
fig.4 Rue des Lavandriers, Charles Marville, tirage sur papier albuminé
/ fig.5 repro : tirage baryté viré au sélénium
- Le fac-similé est réalisé suivant le
procédé original de l’œuvre à reproduire.

fig.6 Portrait de femme,
vers 1860, tirage sur papier salé / fig.7 matrice jet d’encre / fig.8
fac-similé
Pour qui ?
Aujourd’hui, le laboratoire produit 10 000
images documentaires et 500 reproductions pour exposition par an. 80% de
celles-ci sont des impressions jet d’encre, dont les couples
encres-papier sont choisis en fonction de leur qualité de conservation
et de leur aspect de surface. 20% des travaux sont argentiques.
La très grande fidélité de restitution et
la rapidité d’exécution des contretypes numériques engendrent une perte
d’intérêt des conservateurs pour le fac-similé. Aussi, une copie
réalisée dans un autre procédé que l’image originale se distingue
forcément de ce dernier. A contrario, le fac-similé reste la recette
pour créer des faux.
Le fac-similé me semble pourtant
bien plus proche de l’objet original, autant d’un point de vue éthique
qu’esthétique. J’ai cherché des situations pour lesquelles ce type de
reproduction est la seule alternative convenable à l’exposition d’une
œuvre originale. La reproduction de daguerréotype entre dans ces
situations.
Étude de cas :
la reproduction d’un daguerréotype

fig.9 Victor Hugo de
profil, avant le 22 avril 1853,
réalisé par un de ses fils ou son gendre
Ce procédé semble complexe à amorcer. En
effet, l’image apparaît sur une plaque métallique sensibilisée puis
développée à l’aide de chimies « toxiques » que l’on utilise rarement
sous ces formes.
Je suis utilisateur de plaques de cuivre
dans mes recherches autour de la gravure de photographie pour les
éditions Malaxe. D’autre part, l’alternative proposée par la méthode
Becquerel pour le développement amoindrit considérablement l’usage de
produits proscrits dans les laboratoires de la Mairie de Paris.
Finalement, il ne me manquait que de l’iode (Disactis
en fournit), un argenteur raisonnable et quelques petits bricolages.
Depuis 2010, j’ai pu consacrer 2 périodes
à ce travail. En juillet 2010 avec Carole Sertillanges, en apprentissage
à l’AFOMAV, nous avons eu le temps de nous familiariser avec le procédé.
Puis en juillet 2013 avec Audrey Laurans, étudiante à l’ENS Louis
Lumière, nous avons obtenu des résultats suffisants pour les présenter
aux collections.
Voici le protocole employé ainsi que les
difficultés rencontrées :
Polissage du plaqué argenté et
sensibilisation aux vapeurs d’iode
Polissage au touret « à l’américaine » et
finition au velours, nous permettant d'obtenir une plaque propre et sans
rayure. Puis sous lumière atténuée, exposition aux vapeurs d’iode ; la
plaque prend différentes couleurs suivant des cycles connus. Coming Into Focus (John Barnier ISBN : 978-0811818940) ainsi que de nombreuses
discussions sur les forums spécialisés s'accordent sur l'utilisation de
la plaque dès l'obtention d'une couleur jaune homogène (pic de
sensibilité) au troisième cycle (plus longue dynamique d'exposition).
Exposition
La plaque sensible est directement en contact avec le
modulateur dans un châssis-presse placé sur un pupitre type art
graphique. Il s’agit d’une lampe ultraviolette ponctuelle destinée au
photopolymère, utilisée généralement pour l’imprimerie.
La couleur du
modulateur (positif sur transparent jet d’encre) est déterminée suivant
l’évolution des valeurs par composante colorée obtenue sur le
daguerréotype. Pour simplifier la lecture des résultats plus ou moins
aléatoires, la calibration est effectuée avec le script Chartthrob sous
Photoshop puis modifiée à l’œil au pied et épaule de courbe.
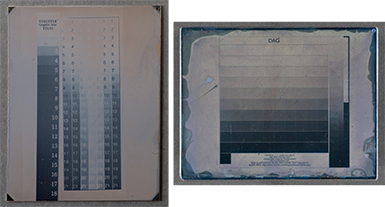
fig.10 et 11 Détermination
de la couleur du modulateur et de sa courbe de tirage
Développement par la méthode Becquerel
Becquerel a proposé dès 1840 une méthode alternative au développement
par les vapeurs de mercure, il s'agit d'un développement physique plutôt
que chimique. Le signal est amplifié en exposant la plaque à une lumière
complètement différente de l'exposition aux UV.
Nous avons commencé par
des expositions sous filtre inactinique en plein soleil, puis évolué
vers un système qui n’est pas tributaire des conditions météorologiques.
La température atteint les 70°C, d’où le recours au ventilateur.
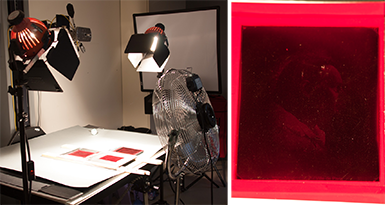
fig.12 et 13 dispositif
mis en place
pour le développement Becquerel
Fixage puis virage
La plaque est fixée
et lavée. Le virage va contraster l'image, la réchauffer et en limiter
sa fragilité. Il fait aussi apparaître l'ensemble des défauts survenus
au cours du traitement.

fig.14 reproduction fixée
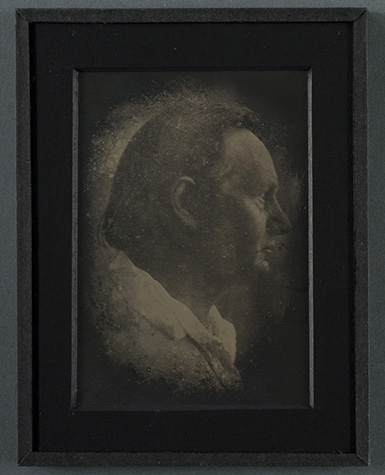
fig.15
reproduction virée

fig.16 originale
Je n’ai pas encore eu le temps de voir
Alexandrine Achille, Conservatrice des photographies de la Maison Victor Hugo.
Ces expérimentations ne sont qu’une ébauche. Afin d’obtenir
rapidement des résultats, nous avons choisi de bloquer de nombreux
paramètres. Comme tous les procédés, le daguerréotype nécessite plus de
deux mois pour que l’on puisse jouir pleinement de ses possibilités.
Concernant l'utilisation de ce procédé pour la reproduction, il engendre
des rendus de détails tellement fins que le positif sur transparent jet
d'encre en devient grossier. Je travaille en ce moment sur un protocole
de prise de vue d’une reproduction agrandie sur papier éclairée par un
banc de lumières type fluo-compacte pour effacer le rendu des buses.
dernière modification de cet article :
2013
|